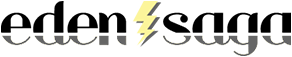Il ne se passe pas un seul jour sans que je me souvienne. Depuis 70 ans nous sommes plus que frères, compagnons de route, soldats de la lumière, visiteurs de l’astral. Le 14 février, ton anniversaire, mon cœur se serre plus qu’à l’ordinaire.
Je revois les cent mille tours que nous avons faits, les cent voyages, les dix mille délires, toutes ces folies des sages que nous fûmes. Et je pleure.
Mais ce n’est pas triste, mon Devic. Ton souvenir est émouvant comme la vie. Ta mort m’émeut moins que ta vie. Toute vie m’émeut. La tienne m’a ravie. Merci pour ces années de compagnonnage, puis de maîtrise, enfin de vieillesse que nous nous sommes accordées l’un à l’autre. Merci le Vivant, merci le mort. Les morts. Table rase, sensation de solitude qui ne se peut combler… Au chant de la fauvette ou celui d’un ruisseau, je rigole à nouveau.
Le souvenir est là, complet, indubitable. On en a gravi des sommets, tour à tour premier de cordée. Tour à tour exténué. À deux doigts d’abandonner. Le courage qu’on s’est donné. L’amour d’aimer. Douces mémoires intimes, aigre douceur d’aimer, chagrin, folie, domine la douceur. Un ami tel que toi ne se voit pas deux fois.
– Toi, t’aimes bien te plaindre ! dit ma chérie. Elle a raison. J’adore me plaindre, et j’aime encore mieux être plaint, la tête sur un sein rassurant. Y a pas d’âge pour faire le bébé. Ma chérie emplit ma vie. Mais malgré tout ce qu’elle est, tout ce qu’elle peut être, ce grand amour ne peut combler le vide énorme que m’a laissé ton départ, ami Devic. Pas un seul jour sans ton souvenir. Des petits riens. Des rires. La chaleur d’être encore si proches après tant d’années d’errances. Et d’erreurs.
Alors s’enchaînent sensations, impressions, brumes diaphanes, sons ouatés dans le fond du lointain. Toute une vie de copains ! Ma relation la plus fidèle, ami Jean-Claude, ce fut toi. Où que je hume ces brumes, un sourire survient qui m’emporte. Et je ris. Émergeant du lointain ton rire me revient, tout secoué de soupirs. Tu ris comme on respire.

Nous étions trois compagnons de route, sur une route isolée, montante, ignorée de la plupart. La vie coulait pleine de mystères élucidés, de magie folle, de rires et d’accolades. La chaleur de notre amitié se riait des frimas. Quelques femmes revêches nous appelaient le trio infernal. Qu’est-ce que l’enfer venait faire ici ? Trio inséparable, oui, ça oui. Jusqu’à ce que la mort nous sépare…
Elle l’a fait, l’immonde gueuse. Elle a fauché les meilleurs des hommes, épargnant des milliards de pires. Bien pires. Et je me retrouve tout seul, collée à ma Bretagne comme une moule sur son rocher. Certes, de nouveaux amis me rendent visite. Je ne suis pas seul, non, ça non. Mais il y avait Flornoy qui veillait sur Devic et moi. Après son départ, Devic s’est éloigné un peu, pas longtemps, pas trop loin, mais quand même.
Pendant près d’un an, la maladie l’a cloué sur un lit d’hôpital. On s’est revu, il n’était plus qu’un vieux invalide. On dit que l’hôpital guérit, il abîme, il mutile, il tue aussi. Devic n’a pas supporté cette déchéance et son échéance inéluctable. Il s’est battu, contre lui-même, contre sa faiblesse humiliante. Et puis il est parti, au bout du rouleau. Et me voilà ce soir.
Le trio infernal se résume à l’angélique Xavier. J’ai changé. Le poids des années m’a été ôté. La vigueur m’a permis de nouvelles avancées. Mes lecteurs, tous ces nouveaux amis, m’ont appris un nouveau printemps. Pour combien de temps ? Beaucoup. Des années. Avec cette épée de la dame au clebs suspendue au dessus de ma tronche. Ne pas m’enfler. Ne pas m’installer. Ne pas quitter cet humour qui me mène, l’ironie, la distance que crée le rire afin de résister à l’effroyable tentation du vide.
Pas celui de la mort, non. Celui de l’orgueil. Me croire indispensable. Irremplaçable. Laisser revenir plus fort cet ego que je n’ai cessé de combattre. Fuir les admirateurs, adorateurs, adulateurs. Ils croient bien faire à chercher le gourou. Je n’en suis pas un. Au grand jamais.
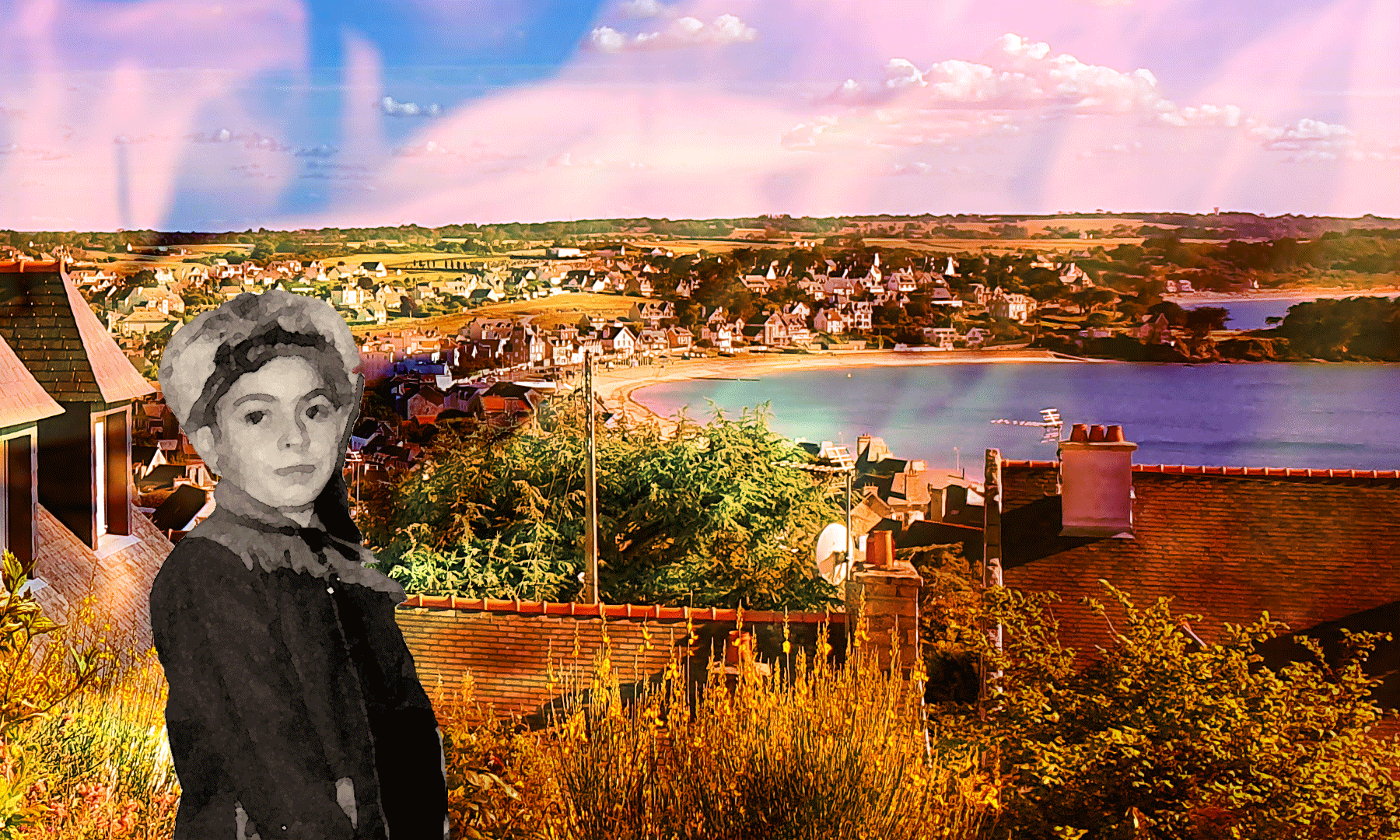
Je suis tout petit, cherchez la route avec moi, écrivais-je il y a quarante ans. C’est toujours le cas, je sens que ça durera.