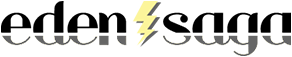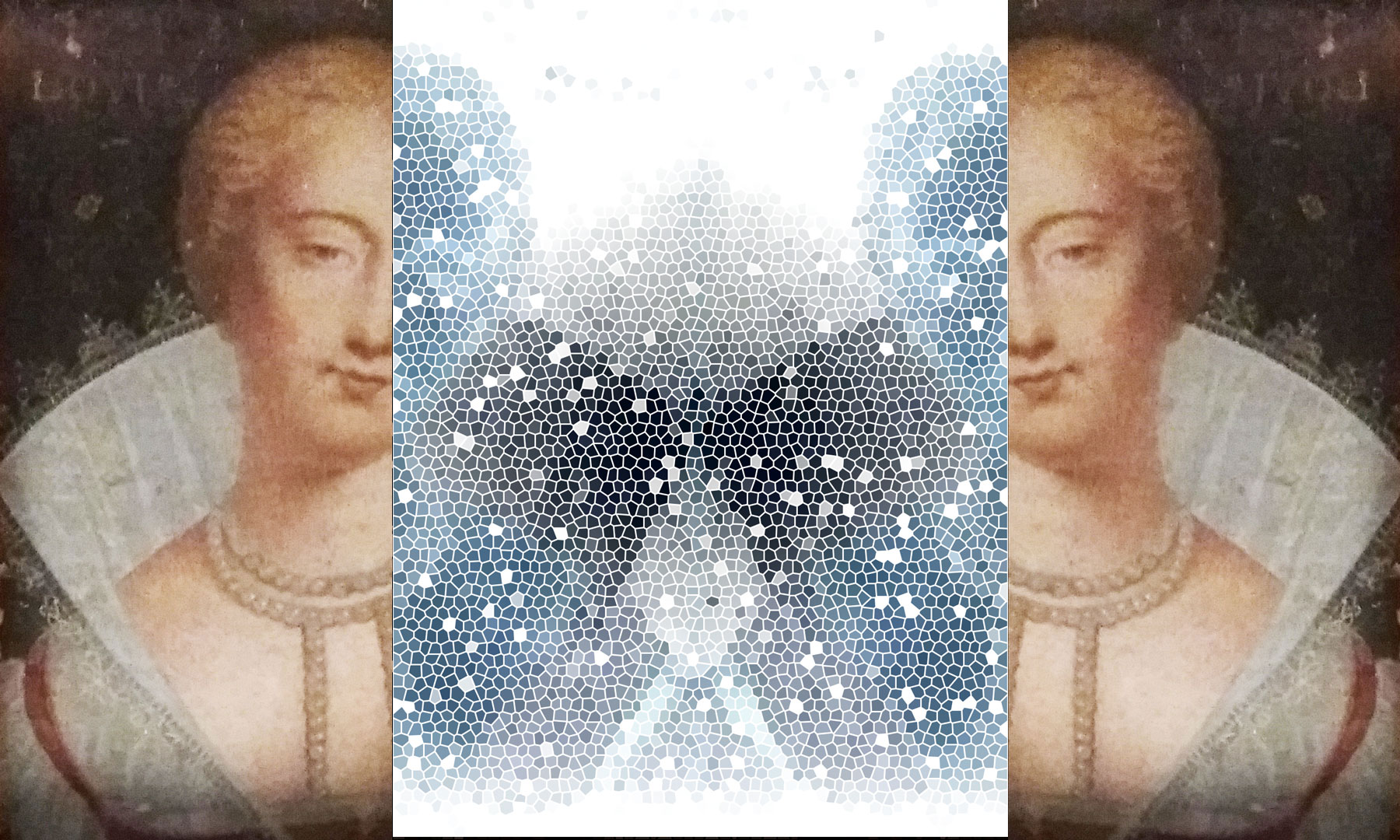
On l’appelait la Belle Cordière. Cette éminente poétesse de la Renaissance est aussi une jolie cachotière. Un de ses plus fameux sonnets a bien des choses à dire… à qui prend le soin de le lire. Si sa poésie nous touche tant, c’est qu’elle décrit l’indescriptible pour exprimer l’inexprimable.
Louise Labé est née à Lyon aux alentours de 1524. Surnommée la Belle Cordière car elle est fille et épouse de cordier, Louise Labé est une enfant vive et enjouée qui fascine son père. Celui-ci lui donne une éducation assez exceptionnelle pour une femme du peuple au 16e siècle. Elle apprend le latin, l’italien l’espagnol, quelques rudiments de grec, la musique, le luth, mais aussi tous les arts des armes traditionnellement réservés aux hommes. Elle a le cœur héroïque.
Au mépris des condamnations religieuses de l’époque, elle s’habille en homme pour monter à cheval tel un écuyer et s’illustre aux jeux martiaux de la joute. Comme son modèle Jehanne la Pucelle, ayant laissé « les molz habiz de femme » Louise s’enrôle sous les bannières de France. A dix-sept ans, la voilà chevauchant par les vaux du Roussillon.
Voilà pour sa biographie habituelle que vous pourrez trouver partout. On ne sait pas grand chose sur celle qui fut pourtant la plus importante poétesse de la Renaissance. Mais à lire le sonnet qui suit, on comprend qui elle fut vraiment. Et sur quel chemin elle a progressé…
Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ;
J’ai chaud extrême en endurant froidure :
La vie m’est et trop molle et trop dure.
J’ai grands ennuis entremêlés de joie.
Tout à un coup je ris et je larmoie,
Et en plaisir maint grief tourment j’endure ;
Mon bien s’en va, et à jamais il dure ;
Tout en un coup je sèche et je verdoie.
Ainsi Amour inconstamment me mène ;
Et, quand je pense avoir plus de douleur,
Sans y penser je me trouve hors de peine.
Puis, quand je crois ma joie être certaine,
Et être au haut de mon désiré heur,
Il me remet en mon premier malheur.
La chevalerie céleste
Mon benefactor et ami Jean-Claude Flornoy citait volontiers ce texte parce qu’il y trouvait la description parfaite de l’arcane XII Le Pendu. Selon lui, ce sonnet traduisait exactement le ressenti intérieur vécu à ce stade, tout proche de l’éveil. Le Pendu est le premier arcane de la chevalerie céleste, et l’arcane précédent, XI La Force, représente l’aboutissement de la chevalerie terrestre.
Pour ma part, j’y vois la description précise de toute la chevalerie céleste, cette phase de vie si particulière où la personne remise son ego et commence une guerre sans merci, de chaque instant, contre les sortilèges du mental dominant, celui que j’appelle le dragon de l’ego. L’éveillé est encore au monde, mais il n’est plus du monde. Il a cessé d’appartenir au monde, à la matière, à la terre, à la nature, à l’humanité, au règne des vivants. Il est encore parfaitement conscient de toutes ces merveilles, mais il ne s’en émeut plus guère. Les merveilles de l’au-delà, déjà, sont à sa portée.

Tristesse sans cause
Juste, au hasard des soirs, ressent-il une poignante nostalgie du Grand Tout, que nos créateurs appelaient le AL. Cette nostalgie-là, je la connais bien depuis si longtemps. Moi qui ai beaucoup lu, je ne l’avais jamais reconnue, jamais entrevue dans mes lectures. Les Portugais et les Brésiliens ont un mot pour la désigner, mot qui est à lui seul tout un poème : saudade. (musique) Quelle ne fut pas ma joie de la retrouver, parfaitement décrite, sous la plume de Carlos Castaneda qui l’appelle joliment la tristesse sans cause du guerrier.
Une tristesse sans cause ne peut pas se maintenir. Pourtant cette bizarre et poignante nostalgie m’étreint depuis l’enfance. Elle n’est jamais bien loin, même dans les moments d’extase. Cette tristesse n’est pas sans cause. Son origine est si profonde, la blessure est si incurable qu’elle se réveille pour peu qu’un rien l’effleure.
La vie m’est et trop molle et trop dure.
J’ai grands ennuis entremêlés de joie.
Tristesse entremêlée de joie. Jouissance imprégnée de douleur. Chagrin si vif qu’il peut me tuer, jubilation si totale que je pourrais m’y noyer. Oui, chaque mot de ce grand poème me bouleverse et m’élève. Ce que je vis d’autres l’ont vécu. Ce que je transmets est un trésor sans prix. Je n’ai pas de religion, pas d’idole vivante ou morte, pas de conviction qui tienne lieu de prison. Libre et maître de moi. Bonheur que je vous souhaite à tous.
Méfaits de la mode
Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie ;
J’ai chaud extrême en endurant froidure
Quand j’ai la grande joie de tomber sur un texte aussi fort et aussi utile que celui-là, je m’empresse de le répandre. On lit trop peu les grands textes des classiques et des anciens. Pour un jeune, la mode se démode chaque matin. Maîtresse indomptable, elle dicte les fringues, le look, la façon de parler, de penser, de chanter, de rire, de marcher, de se distraire, de se reproduire.
Alors que la pensée profonde et vive se meurt dans les amphis, alors que l’école est devenue sectaire et résolument rétrograde, il serait foutrement urgent de relire les maîtres d’hier et d’avant-hier, ceux dont je m’obstine à vous parler dans mes articles et les autres, innombrables, qui m’ont ouvert l’esprit, le corps et le cœur.
La mode sacro-sainte, dictatrice effrayante, les a classés ringards. Personne ne les lit plus. Je m’y plonge toujours avec délices. Mais moi la mode je l’encule. Qui pour en faire autant ? Si tu veux t’habiller en gnou, fais-le. Si tu veux faire des crêpes à Oulan-Bator, c’est d’accord. Si tu veux marcher sur les mains, mets des gants. Ou va dans les champs. Les villes sont pleines de merde et de chiens.
L’argent
L’éveillé s’en fout. L’argent ? Il n’en a pas, il n’en manque pas. « Mon bien s’en va, et à jamais il dure » écrit Louise. Si tu te détournes des choses matérielles pour te tourner vers la lumière, dit le proverbe, les chose matérielles te suivront comme ton ombre. L’argent est encore utile pour survivre en ce monde marchand. Le troc existe, il faut l’encourager. Le don existe aussi, il fait survivre les êtres de ma trempe. En Inde, de nos jours encore, sadhus, moines errants et bonzes vivent ainsi de la charité publique.
Il devrait en être de même partout, comme c’était le cas jadis. Mais finalement ça n’a pas d’importance. Mon bien s’en va et à jamais il dure. Si d’aventure je m’inquiète parce qu’une grosse facture vient de tomber — les travaux d’entretien se sont succédés avec une rare vigueur — je reçois la somme exacte sous forme de don. Et je m’émerveille. Et je me reproche de douter. Je me suis tourné vers la lumière, les choses matérielles me suivent comme mon ombre.
Avoir confiance n’est pas suffisant. Il me faut faire confiance. Faire confiance à mon pilote et le remercier de se soucier de moi. Il me connaît par cœur, je ne sais rien de lui. Mais pour tout ce qu’il me fait, tout ce qu’il me dit, je le remercie sans répit.