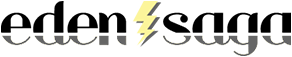Moi, Isis, fille de la Déesse, enfant des étoiles, je t’ai suivi dans mon jardin magique. Je te cherche, ô mon Idriss, je te veux près de moi. Plus près, mon amour, ma vie. Prends-moi. Je tremble aussi. Je te fais don de moi. Que la vierge soit faite femme en tes bras.
Toute la nuit ils ont vogué de conserve, naviguant tantôt sur mer belle, tantôt au creux des vagues. Le vent de la passion les a roulés d’un bord à l’autre. La tempête a ravi leurs corps trempés. Ils se sont débattus. Ils se sont enlacés, froissés, cassés, caressés sur la crête des lames qui les projetaient vers le ciel. Brisés dans leur élan par une vague scélérate, ils se sont pris comme on prend la mer. Tel épris qui croyait prendre. Ils ont touché terre bien avant l’aurore. Isis était femme, Idriss était homme, les deux étaient heureux comme peu le sont. Haute consécration, délicieux offertoire, sublime eucharistie.
– L’encens aphrodisiaque est né. Notre vierge païenne existe, fredonne Idriss qui cuve sa jouissance.
– Que dis-tu ? s’écrie la jeune femme. Isis n’a rien perdu des souvenirs d’Hathor. Comment pourrait-elle oublier ce morceau ? C’est un des grands airs de l’Opéra d’Alcor, écrit et composé par Idriss à l’époque où il était encore dans le corps d’Hénoch. Retrouverait-il enfin sa mémoire ?
– Ce morceau, d’où le connais-tu ? Qui te l’a appris, Idriss ? Réponds, c’est important.
– Qu’as-tu soudain ma bien-aimée ? Te voici différente. Où est la tendre Isis que j’ai cajolée sur la plage et qui m’a mangé de baisers sous l’orage ?
Isis se mord la lèvre. Elle sait bien qu’elle ne doit pas le heurter de front. Il n’est pas encore prêt. Le manteau d’Hénoch est trop large pour ses jeunes épaules. Idriss ne se soucie pas de retrouver sa mémoire, pourtant elle revient dans sa face. Isis doit se taire. Elle doit l’aimer. Les petits mâles sont parfois si frêles, si fragiles ! Un souffle les fléchit. Un rien leur fait ombrage. La Déesse ne veut pas gâcher la beauté du retour à la vie. A l’envie.
– Isis, j’ai tué un homme, chuchote le jeune homme. J’ai cru me réveiller d’un cauchemar, mais non, c’est vrai. J’ai tué un homme de mes mains.
– Oui, Idriss.
– Cet homme était un sage. Il s’appelait Rama.
– Oui, Idriss.
– Je n’ai pas voulu. Je l’aimais ! La vie lui pesait trop, il m’a tendu un piège. Par ma main, il s’est tué lui-même !
– Oui, Idriss.
Autour d’eux, le jardin a changé. Il revêt sa parure éclatante, les colibris gazouillent dans les micocouliers. De grandes draperies d’orchidées éclatantes sont descendues des frondaisons. Autour des calices épanouis volettent des nuées d’oiseaux-mouches, de ceux qu’on nomme baise-fleurbeija-flor au Portugal. Un héron marche d’un pas mécanique sur la marge d’un étang bleu. Plus loin, bruyant et doux, se pose un vol de flamants roses. On dirait que la vie vient d’éclore. Tout est calme, serein.
Idriss tremble. S’il pouvait arrêter le cours invariable du temps, avec quel plaisir il retournerait à l’instant où Rama lui tend l’épée mortelle. Avec quelle joie il la refuserait ! Pouvoir encore serrer dans ses bras ce qui était un homme hier encore, et qui n’est plus qu’un corps. Comment peut-on perdre la vie quand la vie est partout autour de nous ? Pourquoi faut-il qu’un jour elle s’arrête, comme si elle n’avait jamais commencé ? Idriss pleure. Il ne sent pas les larmes mouiller ses joues imberbes. Il ne sent pas le doigt de son aimée qui dessine le contour de ses lèvres, et qui, une à une, sèche ses larmes.
Le temps est un serpent qui s’enroule autour de mon bras. Comme un ressort mon bras se détend. Le temps est une épée qui vole vers sa proie. Dans un silence assourdissant, l’arme frappe. Le temps m’éreinte et m’éparpille. Nous étions l’innocence, la jeunesse insouciante. L’amour nous tenait bon, et voici qu’il vacille comme la flamme d’une chandelle au vent. D’où vient cette crainte de te perdre, ô mon amour, ma bien-aimée, ma colombe, ma paix ? J’ai joué, j’ai perdu. Vois mon cœur à nu. Me voici parricide.
Rama était si bon, comment peut-il mourir ? J’étais un fils pour lui. Il voulait me donner… Quoi au juste ? Que m’a-t-il laissé d’autre que le remords sans fond, sans borne, sans lumière ? Je me meurs, le mort saisit le vif, voici le vieux Lama qui me tire par les pieds. Protège ton amant, exauce sa prière. Fais-lui place en ton nid, douce Déesse qu’il aime plus que la vie. En ce beau jour de ton retour, vous avez fait l’amour, pourtant son cœur est lourd. Le sens-tu ? le sang sur ses mains n’est pas le tien. Le vois-tu ? Trop de sang ! Trop de morts… Tous ces corps qui souffrent, les vois-tu ? Tant de vies volées, tant d’instants envolés, de blessures qui jamais ne seront refermées.
Mais toi, mon Isis. Quand je t’ai connue, tu étais ma mère. La Déesse que chacun respecte, la grande Hathor m’a offert son divin corps – à moi, pauvre Hénoch. Elle s’est donnée à moi, je l’ai aimé comme on aime un jour sans fin. L’éternité fut notre couche, l’adultère fut notre lit. J’ai cueilli des mots sur ta bouche qu’aucun de tes fils n’entendit. Tu m’as donné plus que des ailes : un corps tout neuf. J’étais le veuf et l’orphelin, je suis le bœuf du sacrifice. Que le temps arrête ma main ! Que le sort enfin soit propice !
La jeune Déesse ne répond pas. Tendre, elle laisse courir ses doigts sur le torse de son homme. Elle est heureuse. Elle a retrouvé celui qu’elle aime depuis si longtemps, elle a violé pour lui de nombreux règlements. La Déesse en charge de ce monde a prolongé indûment les jours de son amant. Elle lui a fournit un autre corps, à lui qui n’est qu’un éphémère. Par sa faute, un mortel pourrait ne pas mourir, quand tant de dieux n’auront jamais cet avantage. La mort frappe à tout âge. Sais-tu le jour, connais-tu l’heure ? Mon bel amour, aimons-nous, aimons-nous encore, que notre amour dessine l’avenir et le pare de somptueux atours. Chacun son vœu, chacun son tour. Quel est le tien, Idriss ? Je suis la fée Isis, je peux tout exaucer. Je peux tout exhausser.

Idriss est silencieux. Voici qu’il a connu sa mère, voici qu’il a tué son père, voilà qu’il ne s’en soucie guère. Par bonheur, par malheur, ce qui est fait demeure. Nul humain n’y peut rien. Les pleurs sont importuns. Il a baissé les yeux sur sa femme et sa main s’est posée sur un sein qui palpite. Il veut revivre en elle, ne plus penser à rien. Il est bien. Tout désespoir est vain.
– Aimons-nous, ma sirène.