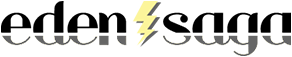On ne t’a pas laissé le temps. On t’a largué comme ça au milieu du monde, sans te le dire, sans te montrer. Tu te rends compte qu’on a pas eu ce temps, ce temps-là qu’on devrait se donner, les uns aux autres. Parce que pour vivre, ou plutôt survivre, on va très vite. Parce que se loger, boire et manger, c’est géré d’une certaine façon, ici-bas ils ont breveté la vie. Les fous.
Tu commences chez tes parents, c’est naturel. Puis tu dois te trouver un coin pour vivre. Si tu étudies dans un pays riche, tu peux avoir de la chance et un loyer payé par l’État. Mais ensuite, pour te trouver un toit, et ne pas dormir dehors, il faut trouver de l’argent quelque part. Et puis d’abord, pourquoi on ne vit pas dehors ? On ne nous a même pas laissé le choix… Évidemment, qui voudrait dormir dehors en ville et subir le sort des sans abris ?
Si l’éducation coûte cher, essaie l’ignorance.
Mais d’ailleurs, pourquoi devrait-on vivre en ville ? Et pourquoi ne pas dormir dehors dans les forêts ? Près des lacs ? Dans les collines ? On ne nous a pas laissé le temps. Tout s’est précipité. Nous tous, ici, on galère dans cette jungle humaine, où tout a déjà commencé sans nous. Quelle violence…
On ne t’a pas appris à parler, Tu as dû apprendre seule. On ne t’a jamais appris à respirer, et tu ne sais toujours pas bien le faire. On ne t’a pas non plus appris à manger. Ni à sentir les températures, à faire pousser les plantes, à cultiver ta nourriture. Tu te sens la proie de prédateurs avides.
On ne t’a pas appris à regarder les choses, à assouplir ton corps. On ne t’a pas accompagné dans ton épanouissement personnel. En fait, on n’a pratiquement rien fait pour toi, et en même temps, ceux qui t’aiment le plus, tes parents, ceux qui s’occupent de toi, ont juste fait ce qu’ils ont pu. Ce qu’ils croyaient normal de faire pour toi, comme les anciens avaient fait pour eux.

On vit très peu de temps je crois… Quel gaspillage. À 20 ans on devrait déjà savoir déjà peindre, dessiner, travailler le bois, travailler la terre, reconnaître les plantes, écouter les autres, connaître son corps, avoir lu les livres des auteurs, intégré des groupes de travail sur la compréhension et le ressenti de l’instant. Avoir été initié aux mystères des énergies, de l’esprit, du monde invisible. Avoir fait des transes personnelles, des transes collectives, et aussi avoir commencé à réaliser sa prédilection, et avoir presque compris qui l’on est pour poursuivre le reste du chemin avec bonheur et confiance.
Quelle frustration, c’est dur de ne pas y penser. De laisser couler… de se dire que c’est comme ça, pas la bonne époque, devoir se battre pour arracher le savoir et la connaissance des livres, d’internet, du cinéma, et de l’instant, sans personne pour nous accompagner.
Parce que tout le monde est occupé dans un monde étranger au modèle de la nature, sauvage, équilibrée, généreuse, diverse, lente, reliée. Nous sommes tout le contraire : isolés, suffisants, semblables, avares, entêtés, illusionnés, pressées, jaloux, cupides.
Qu’est ce que tu aimerais retourner dans l’amour total, le don de tout, à chaque instant. Dans le silence. À part les chants, les blagues et quelques instructions techniques. Parler, toujours parler… À quoi bon ? Quel retard sur l’instant !
Je pense à toi mon frère, à toi ma sœur. Je suis devant mon ordinateur et je me surprends à ne plus vouloir comprendre, à faire semblant d’être con, à nier… Pourquoi je tapote sur ce clavier ? Pourquoi la lumière au néon ? Pourquoi la table en plastique, le téléphone, tous ces trucs ? Dans quel but ? Je me sens impuissant, non pas parce que je ne sais pas quoi faire. Je sais parfaitement quoi faire. Écouter, sentir, attendre, agir.
Je suis impuissant parce que je sais que je ne verrais jamais le paradis dont j’ai la nostalgie. Je suis impuissant parce que je sais que ce paradis existe, quelque part, dans le passé, dans le futur, et que j’y étais avec toi.
Je sais aussi que je suis ici, et que j’ai quelque chose à y faire. Je me dis que cette nostalgie, si j’en fais ma force, peut rendre ce monde meilleur. Mais putain qu’est-ce qu’il me manque ce paradis ! C’est dur. J’ai dû y passer beaucoup de temps. Il me manque tant ! Ce temps si bon.
Il n’y avait pas de ville. En tout cas pas les nôtres, inhumaines. Il y avait quelques zones de population dense, mais pas d’immeubles. Sauf quelques sculptures verticales. C’était beau, ça allait si bien avec le paysage.
Personne ne cherchait à s’enrichir ou à acquérir des biens matériels, ni pouvoir, ni renommée. Les gens vivaient, c’est tout, et ça suffit. Il y avait des arbres fruitiers un peu partout, ils étaient immenses. Il y avait des clairières, des lacs, des montagnes, des plaines où des chevaux sauvages galopaient en toute liberté. On les montait dès le plus jeune âge, on s’en faisait des amis.

Les gens adoraient dormir dehors, dans des hamacs, dans des filets, ou dans des petites maisons en bois. Il y avait dans l’air quelque chose de très puissant, une sorte d’électricité, c’était notre énergie… Les enfants fabriquaient des éoliennes, pas pour l’énergie, juste pour faire joli.
On fabriquait des boîtes, des petits meubles. On faisait des jeux d’adresses, de l’art, tout le temps. Et si l’on en avait envie, on s’intéressait aux étoiles. On savait fabriquer des télescopes magnifiques. On voyait très loin, à travers la matière. Il y avait des aéronefs très rapides, silencieux. Ils pouvaient aussi aller sous l’eau. Parfois, ils étaient même en bois !
Il n’y avait pas tant de monde que ça… Quand on le sentait, on s’en allait droit devant pendant des jours, on rencontrait toujours quelqu’un qui pouvait nous apprendre quelque chose. On lui montrait un truc en retour, on jouait un peu de musique ensemble, on se racontait des histoires.
Je crois qu’il y avait quand même des personnes mauvaises, violentes, oui, je me souviens de ça. Mais il n’y avait ni police, ni juge, ni prison. On prenait ces durs avec nous, on les emmenait voir un ancien si le cas était grave. Mais jamais de vengeance, l’idée ne nous effleurait même pas l’esprit.
Les gens avaient de ces visages… d’anges. Et de toutes les couleurs, selon l’endroit. Il y avait un parfum magique, on se parlait, on riait, on se faisait des blagues juste pour le fun. Il y avait partout cette sensation chaude, intense, comme si on se savait les mêmes en dedans. Tout passait par les yeux, par les gestes. Nous étions gracieux, sauf quand on faisait des grimaces pour faire rire les enfants. Et toujours fascinés par le soleil levant, par le vent, les insectes, par la nuit, les étoiles.
Nous étions heureux, je ne sais même pas si nous en étions conscients. C’était le temps de l’innocence. J’ai mal, oui j’ai mal parce que ça me manque, parce que tu me manques. Et dès que j’y pense vraiment je pleure, la nostalgie me tient, mon pays me manque. Mon origine. Je ne sais où ni quand. Mais j’y étais, et ça me manque. Tu me manques si fort. Ils me manquent tous. J’ai envie de les retrouver, dans ce temps où tout était si simple. Ça n’avait rien à voir…

Pourtant si je suis là, il doit bien y avoir une raison. Si j’ai cet ordinateur devant moi, des parents qui m’aiment, des amis que j’adore, un monde que je trouve beau malgré toute son horreur, il y a une raison. Est-ce que j’ai choisi de venir ici ? Je n’en sais rien. Mais j’y suis, j’y reste. Jusqu’à la mort. Pas question de me barrer sur Mars avec tous ces lâches. J’ai quelque chose à faire. Avec toi. Aimer, déjà. Moi, toi, les autres, la terre.
Apprendre par les livres, et les films, et l’Internet. Écouter. Les sons, les gens, mon cœur, le vent. Sentir. Ma voie, l’invisible, le feu. Agir. Courir, montrer, se battre, marcher, soigner.
Suivre le chemin qui a du cœur. Et rire, putain. Rire.