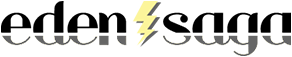On arrivait chez Jean-Pierre par une route étroite, si étroite qu’on avait l’impression qu’elle existait uniquement pour ceux qui savaient déjà où ils allaient. Elle serpentait entre des haies anciennes, noueuses, patiemment taillées par des mains disparues.
Elle longeait des prés où l’herbe avait cette teinte indécise que prennent les choses vivantes quand elles ne cherchent pas à se faire remarquer. Il n’y avait ni panneau, ni portail digne de ce nom. Seulement une barrière de bois fatiguée, qui grinçait comme un avertissement amical : ici, on entre doucement.
Jean-Pierre vivait là depuis toujours, ou peut-être depuis avant même sa naissance, tant il semblait faire corps avec le lieu. Il n’avait jamais quitté sa région, non par refus du monde, mais parce qu’il estimait que le monde venait à lui de toute façon. Et il venait, le monde, sous la forme de bêtes fatiguées, de troupeaux inquiets, de paysans aux épaules basses, porteurs d’une inquiétude muette qu’ils déposaient auprès de lui comme on confie un secret à un puits.
Jean-Pierre était soignant. C’est ainsi qu’on le nommait, faute de mieux. Ostéopathe, disaient certains, homme à mains, murmuraient d’autres, rebouteux enfin. Lui ne corrigeait jamais. Les mots sont des outils utiles, pensait-il, mais ils font parfois plus de bruit que les gestes.
Il soignait les animaux. Non pas comme on répare une machine, mais comme on s’adresse à une mémoire. La première chose que l’on remarquait chez lui, c’était sa lenteur. Une lenteur assumée, presque provocante à l’époque des diagnostics rapides et des solutions prêtes à l’emploi.
 Il estimait que se presser était déjà une forme de violence.
Il estimait que se presser était déjà une forme de violence.
Jean-Pierre marchait lentement, non par faiblesse, mais par fidélité. Il estimait que se presser était déjà une forme de violence. Le monde, selon lui, ne demandait pas à être dominé, mais à être rejoint. Il parlait lentement, posait ses mains avec une infinie précaution, comme s’il demandait pardon avant de toucher.
Celui qui est conscient de sa force et qui garde la douceur de la femme a le Tao entre les mains.
Ses mains étaient larges, solides, marquées par les saisons. Elles avaient travaillé la terre avant de soigner les corps. Il n’avait jamais oublié cela. Il disait parfois — quand on l’interrogeait, ce qui arrivait rarement — que les mains savent avant la tête.
Il disait souvent que les animaux n’ont pas besoin qu’on les comprenne, mais qu’on les écoute. Et écouter, pour lui, ne passait pas par les oreilles. Lorsqu’il entrait dans une étable, il s’arrêtait toujours sur le seuil. Les vaches le regardaient alors, non pas avec curiosité, mais avec une forme de reconnaissance anticipée, comme si quelque chose en elles savait déjà qu’il ne venait pas pour contraindre.
Il respirait avec elles, prenait le temps de sentir l’air, la chaleur, les tensions invisibles qui circulaient dans le lieu. Puis seulement, il avançait. Inutile de lui indiquer l’animal à soigner : par un signal silencieux, l’animal l’appelait.
Jean-Pierre avait appris cela très jeune. Enfant, il passait des heures dans les prés, allongé dans l’herbe, observant les bêtes. Il ne jouait pas avec elles, ne cherchait pas à les apprivoiser. Il se contentait d’être là. Un jour, une vieille jument blessée s’était approchée de lui et s’était immobilisée, flanc contre flanc. Il n’avait rien fait. Il avait simplement posé sa main sur l’encolure chaude, et attendu. Ce jour-là, il avait compris que le soin n’était pas un acte, mais une présence.
Plus tard, lorsqu’il avait appris des techniques, des gestes, des savoirs transmis par d’autres silencieux, il ne les avait jamais pris pour des recettes. Il les avait intégrés comme on intègre une langue ancienne : avec respect, sans chercher à la moderniser.
La connaissance de l’homme ne saurait s’étendre au-delà de sa propre expérience.

Il ne séparait jamais le corps de toute l’histoire. Pour lui, un animal portait plus que son propre poids. Il portait le lieu, le troupeau, les gestes humains, les peurs anciennes. Il disait parfois que certaines douleurs venaient de trop loin pour être soignées brutalement. « Il faut demander la permission« , murmurait-il presque. Et il la demandait.
Son père, paysan taiseux, ne disait rien. Sa mère, elle, hochait la tête en silence, comme si elle avait toujours su. Dans les campagnes, on respecte les évidences muettes. Avec les années, Jean-Pierre avait développé une manière très personnelle de soigner. Une boiterie, selon lui, n’était jamais seulement une boiterie. Elle était souvent le souvenir d’une peur, d’un choc, d’un déséquilibre plus ancien que la douleur elle-même.
« Les animaux n’oublient pas », disait-il parfois, en ajoutant : « Ils pardonnent mieux que nous. »
Lorsqu’il posait ses mains sur une vache, il ne cherchait pas à corriger, mais à dialoguer. Lorsqu’il posait ses doigts sur une bête, il ne cherchait rien, il attendait que le corps parle. Car les animaux parlent. Non avec des mots, bien sûr, mais avec une sincérité absolue. Une tension, un refus, un abandon. Jean-Pierre avait appris à reconnaître ces infimes variations, ces mouvements intérieurs qui disent bien plus que les symptômes visibles.
Ses doigts semblaient écouter les os, les muscles, les flux invisibles qui traversaient le corps. Il attendait une réponse, un relâchement, un souffle différent. Et quand cela venait, il savait que le travail avait commencé. Les paysans regardaient cela avec une forme de respect inquiet. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils voyaient les résultats. Des bêtes qui se relevaient, qui mangeaient de nouveau, qui retrouvaient une paix étrange, presque contagieuse.
Mais Jean-Pierre ne soignait pas que les animaux. Il ne l’aurait jamais dit ainsi, mais les hommes et les femmes qui l’appelaient venaient souvent chercher autre chose qu’un soin alternatif. Ils venaient déposer leur fatigue, leur solitude, leur sentiment d’être devenus étrangers à un monde qui allait trop vite.
Jean-Pierre les écoutait aussi, à sa manière. Il parlait peu, mais ses silences étaient vastes, hospitaliers. Il avait appris à se taire avant d’apprendre à parler. Il pensait que la douleur n’était jamais un ennemi, mais un signal. Et que l’ignorer, ou la combattre frontalement, revenait à se priver de ce qu’elle avait à dire.

Il avait compris cela très tôt et savait que certaines douleurs n’avaient pas besoin de réponses, seulement d’être reconnues. Il disait parfois : « Quand une bête va mal, regardez autour d’elle. » Et souvent, autour, il y avait un humain fatigué.
Un jour d’hiver, on le mena auprès d’une vache qui refusait de se lever depuis trois jours. Les vétérinaires étaient passés, avaient haussé les épaules. L’éleveur, un homme encore jeune mais déjà courbé, n’y croyait plus vraiment. Il avait appelé Jean-Pierre par habitude, par superstition presque. Jean-Pierre entra dans l’étable, s’arrêta, observa longuement. Il ne toucha pas la vache tout de suite. Il s’assit sur une botte de paille, ferma les yeux.
Puis il se leva, posa une main sur le flanc de l’animal, l’autre sur le sol. Il resta ainsi longtemps, immobile, comme un pont fragile entre la terre et la chair. Quand il se releva, il dit simplement : « Elle porte une douleur qui n’est pas à elle. »
L’éleveur baissa la tête. La vache se leva le lendemain.
Jean-Pierre savait que ce qu’il faisait ne rentrerait jamais tout à fait dans les cases modernes. Il n’en souffrait pas. Il avait cette élégance rare de ceux qui ne cherchent ni à convaincre, ni à résister.
Il continuait, voilà tout.
Pour lui, le monde animal n’était pas un monde à part. C’était le même monde, vu depuis un autre rythme. Les bêtes ne trichaient pas, ne théorisaient pas leur douleur. Elles l’habitaient, puis la laissaient partir quand on leur en donnait la possibilité. Il pensait souvent que les humains avaient désappris cela.
Les saisons passaient. Jean-Pierre vieillissait à peine, ou plutôt il vieillissait comme les arbres : en silence, en profondeur. Ses mains, elles, restaient sûres. Elles avaient cette qualité rare de ne jamais s’imposer. Elles proposaient.
Il savait par ailleurs que son monde était fragile. Qu’il reposait sur peu de choses : une écoute, une lenteur, un respect ancien. Il savait aussi que ce monde-là reculait, que les gestes se perdaient, que la vitesse gagnait. Mais il ne luttait pas.

Un soir d’été, alors que le soleil descend lentement derrière les collines, Jean-Pierre reste longtemps seul dans un pré, après une journée de travail. Après une vie de travail.
Les vaches paissent autour de lui, calmes. Il s’assied dans l’herbe, pose ses mains sur la terre. Il se dit — sans tristesse — que tout est bien. Il n’a jamais cherché à laisser de trace. Et pourtant, au moment de s’en aller, il sait que quelque chose continuera grâce à lui. Un équilibre fragile, une manière douce d’être au monde.
Il n’y aura pas de statue pour Jean-Pierre. Il s’en va comme il est venu, dans le silence, à pas feutrés. Peut-être ne laissera-t-il même pas de souvenir précis.
Mais il y aura, longtemps encore, des animaux qui se laisseront approcher sans peur, des humains qui parleront un peu plus bas dans les étables et cette idée, transmise sans mots, que le soin commence toujours par le respect.
Quelque chose continuera.
Une manière douce de tenir le monde.
Une ligne invisible, fragile, mais essentielle.
Et sans bruit, sans fureur, le monde tiendra encore.
Alain Aillet raconte
- Le carnet de cuir
- Le chant des racines
- Aurore en résonance
- Aide-mémoire
- La mésange
- Hervé l’Ancien
- Elle et la grotte peinte
- Le jardin d’effets
- La faille de la quincaille 2
- La quincaillerie des ombres 1
- Message à l’amer
- Le JE décomposé
- Voyageur des étoiles
- Le ruban mauve
- Au café des Immortels
- Le Gué aux Aurochs 2
- Le Gué aux Aurochs 1
- Pech Merle
- Les Fils de la Lumière
- Pour l’éternité
- La planète E
- De Tautavel à Bozouls
- Odieux Odin, effrayante Freya
- Le langage archétypal
- Planète Babel
- Les sons et les langues
- La langue d’or
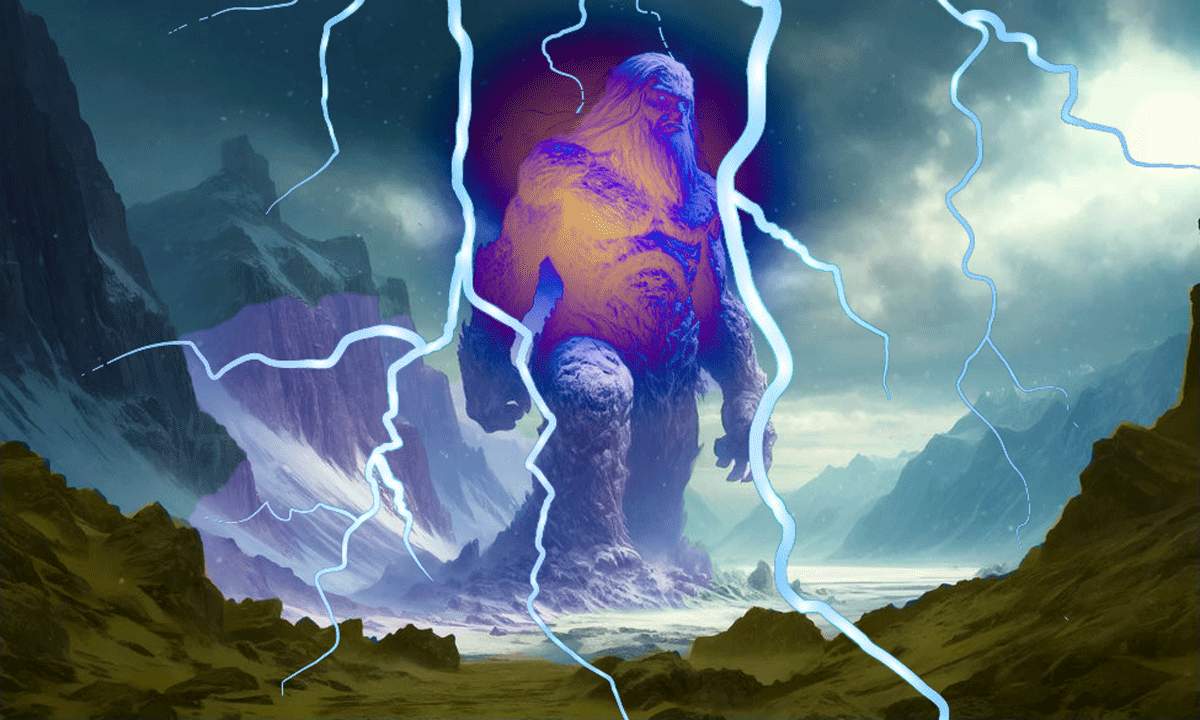 Alain Aillet, Les Fils de la Lumière
Alain Aillet, Les Fils de la Lumière