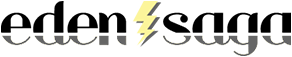Cette fois, je laisse parler plus grand que moi, et de beaucoup ! Il s’agit du meilleur ami de Michel de Montaigne, Étienne de La Boétie. C’est une suggestion de Milla qui m’a tenu compagnie lors de la grande dépression séguinienne des années 2010. Merci à elle!
Discours de la servitude volontaire
(extrait)
« Comment il se peut que tant d’hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d’un tyran seul, qui n’a de puissance que celle qu’on lui donne, qui n’a de pouvoir de leur nuire qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de lui, que de le contredire.
Chose vraiment surprenante (et pourtant si commune, qu’il faut plutôt en gémir que s’en étonner), c’est de voir des millions de millions d’hommes, misérablement asservis et soumis tête baissée à un joug déplorable, non qu’ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu’ils sont fascinés et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d’un qu’ils ne devraient redouter, puisqu’il est seul, ni chérir puisqu’il est, envers eux tous, inhumain et cruel.
N’est-ce pas une infâmie De voir la race humaine Dans une telle course de rats ?
Telle est pourtant la faiblesse des hommes ! Contraints à l’obéissance, obligés de temporiser, divisés entre eux, ils ne peuvent pas toujours être les plus forts. Si donc une nation, enchaînée par la force des armes, est soumise au pouvoir d’un seul (comme la cité d’Athènes le fut à la domination des Trente Tyrans) il ne faut pas s’étonner qu’elle serve mais bien déplorer sa servitude. Ou plutôt ne s’en étonner ni s’en plaindre ; supporter le malheur avec résignation et se réserver pour une meilleure occasion à venir.
 Nous sommes ainsi faits que les communs devoirs de l’amitié absorbent une bonne part de notre vie. Aimer la vertu, estimer les belles actions, être reconnaissant des bienfaits reçus, et souvent même réduire notre propre bien-être pour accroître l’honneur et l’avantage de ceux que nous aimons et qui méritent d’être aimés ; tout cela est très naturel.
Nous sommes ainsi faits que les communs devoirs de l’amitié absorbent une bonne part de notre vie. Aimer la vertu, estimer les belles actions, être reconnaissant des bienfaits reçus, et souvent même réduire notre propre bien-être pour accroître l’honneur et l’avantage de ceux que nous aimons et qui méritent d’être aimés ; tout cela est très naturel.
Si donc les habitants d’un pays trouvent, parmi eux, un de ces hommes rares qui leur ait donné des preuves réitérées d’une grande prévoyance pour les garantir, d’une grande hardiesse pour les défendre, d’une grande prudence pour les gouverner ; s’ils s’habituent insensiblement à lui obéir ; si même ils se confient à lui jusqu’à lui accorder une certaine suprématie, je ne sais si c’est agir avec sagesse, que de l’ôter de là où il faisait bien, pour le placer où il pourra mal faire, cependant il semble très naturel et très raisonnable d’avoir de la bonté pour celui qui nous a procuré tant de biens et de ne pas craindre que le mal nous vienne de lui.
Nul n’est plus esclave que celui qui se croit libre sans l’être.
Mais qu’est donc cela ? Comment appellerons-nous ce vice, cet horrible vice ? N’est-ce pas honteux de voir un nombre infini d’hommes, non seulement obéir, mais ramper, non pas être gouvernés, mais tyrannisés, n’ayant ni biens, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soient à eux ?
Souffrir les rapines, les brigandages, les cruautés, non d’une armée, non d’une horde de barbares, contre lesquels chacun devrait défendre sa vie au prix de tout son sang, mais d’un seul ; non d’un Hercule ou d’un Samson, mais d’un vrai Mirmidon souvent le plus lâche, le plus vil et le plus efféminé de la nation, qui n’a jamais flairé la poudre des batailles, mais à peine foulé le sable des tournois ; qui est inhabile, non seulement à commander aux hommes, mais aussi à satisfaire la moindre femmelette !
Nommerons-nous cela lâcheté ? Appellerons-nous vils et couards les hommes soumis à un tel joug ? Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul ; c’est étrange, mais toutefois possible ; peut-être avec raison, pourrait-on dire : c’est faute de cœur. Mais si cent, si mille se laissent opprimer par un seul, dira-t-on encore que c’est de la couardise, qu’ils n’osent s’en prendre à lui, ou plutôt que, par mépris et dédain, ils ne veulent lui résister ?
 Enfin, si l’on voit non pas cent, non pas mille, mais cent pays, mille villes, un million d’hommes ne pas assaillir, ne pas écraser celui qui, sans ménagement aucun, les traite tous comme autant de serfs et d’esclaves : comment qualifierons-nous cela ? Est-ce lâcheté ?
Enfin, si l’on voit non pas cent, non pas mille, mais cent pays, mille villes, un million d’hommes ne pas assaillir, ne pas écraser celui qui, sans ménagement aucun, les traite tous comme autant de serfs et d’esclaves : comment qualifierons-nous cela ? Est-ce lâcheté ?
Mais pour tous les vices, il est des bornes qu’ils ne peuvent dépasser. Deux hommes et même dix peuvent bien en craindre un, mais que mille, un million, mille villes ne se défendent pas contre un seul homme !
Oh ! Ce n’est pas seulement couardise, elle ne va pas jusque-là ; de même que la vaillance n’exige pas qu’un seul homme escalade une forteresse, attaque une armée, conquière un royaume !
Quel monstrueux vice est donc celui-là que le mot de couardise ne peut rendre, pour lequel toute expression manque, que la nature désavoue et la langue refuse de nommer ?…
La dictature parfaite aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s’évader. Un système d’esclavage où, grâce la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l’amour de leur servitude.
Qu’on mette, de part et d’autre, cinquante mille hommes en armes ; qu’on les range en bataille ; qu’ils en viennent aux mains ; les uns libres, combattant pour leur liberté, les autres pour la leur ravir : auxquels croyez-vous que restera la victoire ?
Lesquels iront plus courageusement au combat, de ceux dont la récompense doit être le maintien de leur liberté, ou de ceux qui n’attendent pour salaire des coups qu’ils donnent ou reçoivent que la servitude d’autrui ?
Les uns ont toujours devant leurs yeux le bonheur de leur vie passée et l’attente d’un pareil aise pour l’avenir. Ils pensent moins aux peines, aux souffrances momentanées de la bataille qu’aux tourments que, vaincus, ils devront endurer à jamais, eux, leurs enfants, et toute leur prospérité.
Les autres n’ont pour tout aiguillon qu’une petite pointe de convoitise qui s’émousse soudain contre le danger et dont l’ardeur factice s’éteint presque aussitôt dans le sang de leur première blessure.
N’aie pas peur du monde, ami. C’est plutôt le monde qui devrait avoir peur de toi.
Aux batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas, de Thémistocle 1, qui datent de deux mille ans et vivent encore aujourd’hui, aussi fraîches dans les livres et la mémoire des hommes que si elles venaient d’être livrées récemment en Grèce, pour le bien de la Grèce et pour l’exemple du monde entier.
Qu’est-ce qui donna à un si petit nombre de Grecs, non le pouvoir, mais le courage de repousser ces flottes formidables dont la mer pouvait à peine supporter le poids, de combattre et de vaincre tant et de si nombreuses nations que tous les soldats Grecs ensemble n’auraient point élevé en nombre les Capitaines des armées ennemies ? Mais aussi, dans ces glorieuses journées, c’était moins la bataille des Grecs contre les Perses, que la victoire de la liberté sur la domination, de l’affranchissement sur l’esclavage.
_____________________
1 Respectivement batailles de Marathon (490), des Thermopyles (480) et de Salamine (480). Ce sont les fameuses batailles contre les Peuples de la Mer, des armées celtes et vikings commandées par le grand Ramos alias Rama.
Notice
Œuvre de jeunesse, publiée en latin par fragments en 1574 puis intégralement en français en 1576. Probablement écrit par La Boétie à l’âge de 16 ou 18 ans.
L’intégrale du Discours est au catalogue de la BNF gratuit, en téléchargement, pdf, courriel, etc.

Étienne de La Boétie
Mon commentaire
Ce grand écrivain a dit ce que je pense mille fois mieux que je n’aurais su faire et tout honnête homme, toute gente dame, devrait lui en savoir infiniment gré.
C’est la noblesse de notre pays de France que de savoir exprimer les pensées les plus extrêmes dans une langue mesurée, qui sonne et se retient dès la première lecture.
J’avais étudié ce discours lors de mes lointaines humanités au collège Stanislas, sous la férule de mon bon maître Jean Millet. J’avais alors l’âge de La Boétie quand il écrivit ce discours.
Vous pourrez trouver dans la section pdf un conte que j’ai pondu à cette époque, Fenêtre sur le vent. J’en avais tiré une chansonnette :
Fenêtre ouverte sur le vent
Fenêtre ouverte sur le vent
Tout vibrant
Sous le soleil des champs
Fenêtre du temps
Ouverte un instant
Sur le vent
C’est bien loin de La Boétie comme de Rimbaud, lui aussi écrivain précoce. Et quel poète! Je n’ai pas la prétention d’appartenir à la somptueuse galaxie des écrivains français, moi qui ne suis qu’un philosophe fou des mythes. Mes vrais talents, plus utiles à mes contemporains, sont d’un autre ordre.
J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges.
Se révolter contre la veulerie des peuples qui acceptent le pire en courbant l’échine, je l’ai fait dès cet âge, sur les barricades de mai 68. Les « événements », comme on disait à l’époque, m’ont inspiré un opéra pop que nous avons répété et enregistré à cinq musiciens pendant toute une année, le soir, après le travail.
Il s’intitulait « Un des fous qui font peur. » Très soixante-huitard, il chantait la révolte contre le vieux monde et la réconciliation des deux sexes. Je ne sais si les bandes magnétiques existent encore quelque part, mais il est trop tard. Mais comme j’eusse aimé pondre un discours comme celui que vous venez de lire !
Pour revenir à Milla, c’est encore à elle que je dois la photo qui suit, prise dans son Jura Suisse. Quelle belle couverture eut-elle fait pour ma Fenêtre sur le vent !

La pensée européenne
- Maître Eckhart
- Oronce Finé
- René Descartes
- La création continuée
- Le cerveau et la pensée
- Baruch Spinoza
- Le libre arbitre
- Le pari de Pascal
- L’art poétique de Boileau
- Emmanuel Kant
- Kant et la raison pure
- Hegel et le néant
- Divines Maths
- Science, ego, magie
- Pensée magique et magie quotidienne
- Karl Marx et Dieu
- Karl Marx et son double
- Charles Darwin
- Quelle évolution ?
- D’où venons-nous ?
- Quel progrès scientifique ?
- La lutte pour la survie
- La réflexion et l’action
- L’Invitation au Voyage
- Correspondances
- Nietzsche l’anarchiste
- Nietzsche le prophète
- Nietzsche le Surhomme
- La volonté de puissance
- Danser dans les chaînes
- Henri Bergson : temps et durée
- Le vitalisme d’Henri Bergson
- Miguel de Unamuno
- Jung contre Freud
- Jung et la synchronicité
- En vérité Wittgenstein
- Albert Slosman
- Marguerite Yourcenar
- Science sans conscience
- Grand temps
- L’Histoire Menteuse